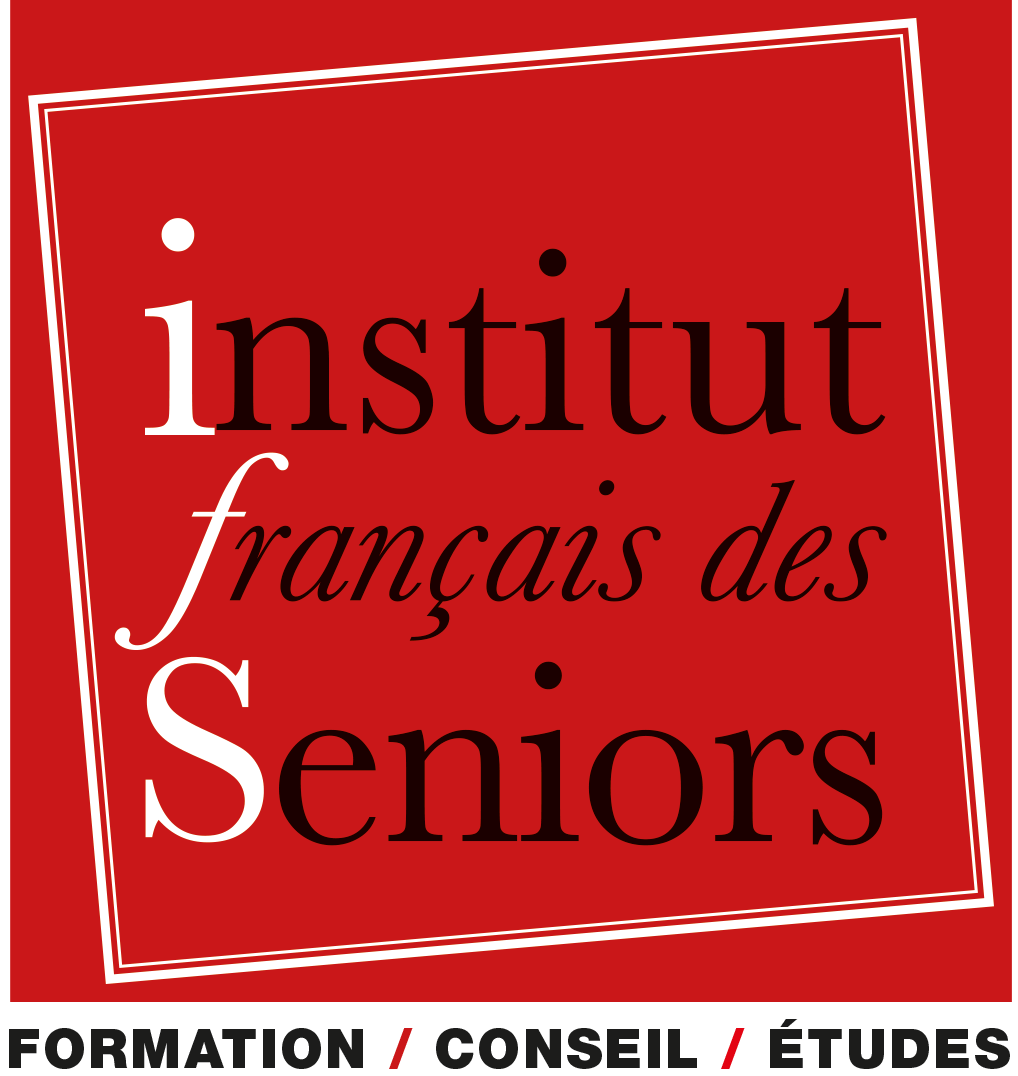Avec le temps ». Quelles certitudes garde-t-on à la fin de la vie ? Comment voit-on la mort lorsqu’elle se rapproche ? Dans cette nouvelle série, « Le Monde » interroge des personnalités sur ce qui passe et ce qui reste. Pour ce premier épisode, André Comte-Sponville pose un regard apaisé sur les années vécues et dit ne plus avoir peur de la mort. Il est âgé de 72 ans.
Comment envisagez-vous votre mort ?
Je souhaite mourir très tard et très vite. Très tard, parce que j’aime la vie et que je voudrais en profiter le plus longtemps possible ; mais très vite, car je redoute les agonies interminables et les handicaps. En revanche, je n’ai jamais eu aussi peu peur de la mort. C’est normal : je n’ai jamais eu aussi peu à perdre. Mourir à 40 ans, c’est une catastrophe, à 15 ans, c’est une horreur. A 72 ans, c’est beaucoup moins grave !
La mort, à l’évidence, ne peut plus me prendre qu’une partie de ma vieillesse, et sans doute pas la plus intéressante. A 40 ans, je pensais tous les jours à la mort. J’avais peur de mourir avant d’avoir écrit les livres que je voulais écrire, c’était très important pour moi. Aujourd’hui, je ne dirais pas que je l’attends avec impatience, mais je l’attends tranquillement.
Etes-vous affaibli d’une quelconque manière ?
Non, pas du tout. J’ai fait un léger AVC [accident vasculaire cérébral] il y a deux ans, dont il ne reste aucune séquelle. Je me sens donc plutôt mieux qu’avant, parce que je suis les conseils diététiques de mes médecins. En revanche, je me sens fragile. Ce n’est pas la même chose. On se sent plus mortel à 71 ans qu’à 40, mais c’est une fragilité que je vis très sereinement. Il m’arrive même d’avoir le sentiment d’une fragilité délicieuse. Plus la vie est fragile, plus on y fait attention, plus elle est précieuse.
Mais cette fragilité n’est-elle pas aussi déchirante ?
Pas du tout. Je le vis plutôt voluptueusement. Il y a une espèce d’hédonisme qui est accentué par la proximité certaine de la mort. Je suis fragile au sens où la mort peut me saisir plus probablement que mes enfants. Mais pour tout le reste, je ne crains pas grand-chose. Peut-être est-ce parce que je suis père de famille avant tout, mais je suis plutôt sensible à la fragilité des jeunes. Mes enfants sont bien plus exposés aux risques de la vie que moi. Pour une bonne raison, c’est que moi, ma vie est faite.
Le principal risque, quel est-il ? C’est de mourir jeune. Eh bien voilà : je suis tranquille. Je suis certain que je ne mourrai pas jeune. Je suis invulnérable face à la mort prématurée. Mes enfants ne le sont pas. Le bienheureux, disait [le philosophe grec antique] Epicure, ce n’est pas le jeune, c’est le vieux qui a bien vécu. Parce que tout ce qu’il a vécu, il peut le mettre dans le « port de la mémoire ». Alors que les jeunes ont leur vie à faire.
A l’âge que j’ai, il est vraisemblable que j’ai déjà vécu le meilleur. Mais ce meilleur que j’ai vécu, personne ne peut me le prendre. Ça n’allait pas de soi. Quand j’avais 16 ans, rien n’allait de soi. Quand j’avais 7 ans, rien n’allait de soi. Comment n’aurais-je pas été inquiet, angoissé ? Maintenant je sais, pour l’essentiel, ce qu’aura été ma vie. Je peux l’oublier, devenir Alzheimer, mourir, et tout ça disparaîtra, mais éternellement il restera vrai que j’ai vécu ce que j’ai vécu. Ce sentiment de l’éternité de ce qu’on a vécu, un peu comme le temps retrouvé de Proust, je le vis comme une délectable sérénité.
Quelles certitudes et croyances avez-vous abandonnées en chemin ?
Le grand changement est arrivé très tôt, vers 18 ans : je suis passé du christianisme à l’athéisme. Ça fait un sacré changement ! Je ne suis pas passé d’une certitude à une autre, je suis passé d’une croyance à une incroyance, avec dans les deux cas le sentiment du doute. Je vénère Pascal, je suis beaucoup plus proche psychologiquement de lui que d’aucun autre penseur. Mais quand il dit qu’« il n’y a de bonheur dans cette vie que dans l’espérance d’une autre vie », je ne peux plus le suivre ! Sans compter que la perspective du salut ou de l’enfer, c’est un poids terrible à porter.
Pour l’athée, tout est plus simple, plus léger, plus libre. Quand j’ai perdu la foi, je me suis senti libéré du regard de Dieu. Certains de mes amis me disent : mais c’est un regard d’amour ! Je leur réponds que, justement, c’est ça le pire ! Lequel d’entre nous pourrait envisager de vivre en permanence sous le regard de sa mère ? Ce serait l’enfer, justement parce que c’est un regard d’amour, qui n’en pèse que plus lourd.
Etre libéré de l’amour de Dieu, ça m’a fait un bien fou, et plus ça va, plus ça me fait du bien. C’est l’humoriste Alphonse Allais [1854-1905] qui disait : « Ne nous prenons pas au sérieux, il n’y aura aucun survivant. » Il a raison ! Quand j’ai découvert qu’il n’y aurait aucun survivant, qu’il n’y avait pas de paradis à espérer, pas d’enfer à redouter, pas de purgatoire, rien du tout : quelle légèreté ! Quelle liberté ! Comme la vie devenait simple ! Donc j’ai perdu la foi pas du tout dans l’angoisse, les craintes, les tremblements, mais dans un grand sentiment de libération, de simplification, de légèreté, que j’ai appelé le gai désespoir.
Les valeurs que vous avez voulu transmettre à vos fils sont-elles les mêmes que celles qui vous avaient été transmises ?
Mon but n’est pas de penser neuf, mais de penser juste. Et quand on pense juste, surtout en matière d’éthique, on a peu de chance de penser neuf ! Qu’est-ce que je peux enseigner à mes enfants ? Que l’amour vaut mieux que la haine, que la douceur vaut mieux que la violence, que la compassion vaut mieux que l’indifférence : des valeurs qui ont au moins vingt-cinq siècles ! Il ne s’agit pas d’inventer de nouvelles valeurs, mais d’inventer une nouvelle fidélité aux valeurs, le plus souvent fort anciennes, que nous avons reçues et que nous avons à charge de transmettre.
Vous-même, est-ce que vous avez déjà pensé autrement qu’en accord avec ces valeurs ?
J’ai pu le croire, quand j’étais très jeune. J’ai eu 16 ans en 1968, et me suis soudain pris d’une passion politique dont les jeunes aujourd’hui n’ont plus vraiment idée. Et comme toute passion est monomaniaque, il n’y avait plus tellement de place pour la religion : Dieu cessa d’abord de m’intéresser, puis je cessai d’y croire. Et quand j’ai quitté l’Eglise, j’ai été pris de la rage des apostats. Quand on quitte une institution comme l’Eglise catholique, on a envie de partir en claquant la porte. Et donc, comme tout le monde, comme des millions de jeunes gens aussi niais que moi, j’ai pesté contre la « morale judéo-chrétienne », toujours réputée répressive, castratrice, culpabilisatrice…
Et puis, comme la plupart des soixante-huitards, j’ai fait des enfants. Et quand on fait des enfants, on découvre qu’il n’est pas interdit d’interdire, qu’il est même interdit de ne pas interdire, et qu’il n’est pas question de vivre sans temps mort, ni de jouir sans entrave. Dès qu’on a un enfant, c’est terminé, toutes ces conneries-là. Donc, on découvre qu’on a besoin de transmettre des valeurs. Lesquelles ? Celles, pour l’essentiel, que l’on a reçues, et spécialement, puisque c’est notre histoire, ces bonnes vieilles valeurs judéo-chrétiennes, juste revues et corrigées par l’esprit des Lumières.
C’est pourquoi je me définis aujourd’hui comme athée fidèle : athée parce que je ne crois en aucun dieu, mais fidèle parce que je continue de me reconnaître dans ce que Spinoza [philosophe hollandais du XVIIe siècle d’origine séfarade], qui n’était pas plus chrétien que moi, appelait « l’esprit du Christ, qui est de justice et de charité ». Relisez les Evangiles : vous verrez qu’il y est question de tout autre chose que de culpabilisation ou de castration !
Et qu’est-il resté de vos passions politiques ?
J’ai été communiste de 18 à 28 ans. D’évidence, je ne le suis plus. Aujourd’hui, je suis plutôt de centre gauche, disons plus proche de l’aile droite du Parti socialiste que de son aile gauche. Le philosophe Alain [1868-1951] a écrit quelque part « la pente est à droite ». Il y a une exception glorieuse, c’est Victor Hugo, pour qui j’ai une immense admiration : lui commence royaliste, légitimiste, et finit quasiment socialiste. Mais voilà, c’est l’exception. L’inverse est bien plus fréquent. C’est vrai pour moi comme pour mes amis : nous sommes tous moins à gauche – ou plus à droite – que nous ne l’étions quand nous avions 20 ans. Et donc, attention, en vieillissant, de ne pas s’abandonner trop à la pente…
Pour quelles raisons pensez-vous que la pente est à droite ?
Il y a deux possibilités. Est-ce que c’est parce que les vieux sont plus égoïstes ? On est plus généreux à 20 ans qu’à 70. Mais il y a une autre possibilité, c’est que les vieux sont plus à droite, ou moins à gauche, parce qu’ils sont plus lucides. Ils comprennent mieux la complexité des problèmes, ils ont plus d’expérience. Je crois que les deux sont vrais, donc j’essaye de ne pas m’abandonner à mon égoïsme de vieillard confortable, qui me déporte un peu à droite. Mais en même temps, je ne vais pas non plus renier ce que la vie m’a appris en matière de lucidité, de complexité, de modération, ce qui m’éloigne de l’extrême gauche.
Je me méfie du simplisme, qu’il soit de gauche – « c’est simple : y a qu’à faire payer les riches » – ou de droite – « c’est simple : y a qu’à réduire le nombre des fonctionnaires ». Eh bien non, ce n’est pas simple, justement. Comment concilier les exigences de l’économie et celles de la justice ? Je ne crois plus que la vérité soit tout entière d’un seul côté, et encore moins du côté de l’un ou l’autre des deux extrêmes. Voilà : le jeune révolutionnaire que j’étais à 18 ans est devenu un social-démocrate modéré, et je l’assume tranquillement.
Vous racontez avoir conçu, enfant, une association entre tristesse et vérité et entre la joie et le mensonge. Comment vous êtes-vous défait de cette idée que la joie était du côté de l’illusion ?
Ma mère était une femme malheureuse dans son couple, et elle est devenue de plus en plus dépressive avec les années. Quand j’ai lu bien plus tard Madame Bovary [de Gustave Flaubert, 1856], j’ai reconnu le même genre de personnage. Il arrivait à ma mère d’être gaie, ou de faire semblant d’être heureuse – c’est comme ça que je le dirais maintenant.
Mais le petit garçon que j’étais sentait bien qu’il y avait là une part d’esbroufe, de cinéma, que quelque chose sonnait faux. Alors qu’inversement quand elle était malheureuse, quand elle me pleurait dans les bras, ça sonnait tragiquement vrai. Dans ma petite tête d’enfant aimant, j’en avais conclu que la joie était du côté du semblant, de l’illusion, et que la vérité, inversement, était du côté de la tristesse.
Heureusement que j’ai fait de la philosophie pour découvrir l’inverse : que c’est au contraire la vérité, le réel, même s’il est parfois cruel et toujours rude, qui permet de prendre sa vie en main et de déboucher sur une vraie joie. Alors qu’inversement, toute illusion amène à la désillusion, donc à la tristesse. Ma mère en est morte. Quand j’ai appris son suicide – j’avais 34 ans –, j’ai repensé à ce que m’avait écrit un psychanalyste : « L’espérance est la principale cause de suicide : on ne se tue que par déception. »
Si j’avais quelque chose à dire à mes enfants, ce serait ceci : ce que la vie m’a appris, c’est que tout espoir est déçu, toujours, y compris et peut-être surtout lorsqu’il se réalise. George Bernard Shaw [dramaturge irlandais, 1856-1950] disait : « Il y a deux catastrophes dans l’existence : la première, c’est quand nos désirs ne sont pas satisfaits, la deuxième, c’est quand ils le sont. » Le problème, c’est que beaucoup de gens, quand la vie les déçoit – et c’était le cas de ma mère –, en concluent que c’est la vie qui a tort. C’est pour moi l’erreur foncière. Qu’est-ce que cela peut vouloir dire que la vie a tort ? La vie fait ce qu’elle peut. Si elle ne correspond pas à nos espoirs, ce n’est pas sa faute : c’est plutôt que nos espoirs sont vains, illusoires, mensongers. Bref, il s’agit d’espérer un peu moins, et surtout de connaître, d’agir et d’aimer un peu plus !
Comment votre idée de l’amour a-t-elle évolué avec le temps ?
Au fond, j’ai toujours célébré le couple, quand il est heureux. Je suis plus réservé sur la passion amoureuse. Je l’ai vécue, comme tout le monde. Mais la passion, il faut bien le dire, n’est pas le moment où on est le plus intelligent, le plus lucide, et on n’en voudra pas aux philosophes de mettre l’intelligence plus haut que la bêtise, et la lucidité plus haut que l’illusion. En revanche, le couple me touche, voire me bouleverse parfois.
Je n’ai été célibataire qu’un an, dans toute ma vie d’adulte. Je ne devais pas avoir la vocation. Et ce qui me frappe maintenant, c’est plutôt la douce simplicité de la vie à deux. Et je crois que c’est vrai de la vie en général : en vieillissant, je me rends compte qu’elle est plus simple qu’on a tendance à se l’imaginer. Ça, c’est peut-être un acquis de l’âge.
Y a-t-il des morts qui vous inspirent ?
Pas vraiment, excepté le Calvaire. La mort du Christ sur la croix, le moment où il dit « Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? », ce moment-là représente pour moi quelque chose de très fort, qui continue de me toucher. Autant je ne crois aucunement à la résurrection, autant ce moment du Calvaire dit quelque chose d’essentiel sur l’humanité : que l’amour, même vaincu, vaut mieux qu’une victoire qui serait sans amour.
C’est exactement notre sort à nous, athées : Dieu nous a abandonnés, puisqu’il n’existe pas ; nous voilà seuls, sans autre secours que notre puissance d’agir, de connaître et d’aimer. Cela me bouleverse bien davantage que quelque résurrection que ce soit !
Considérez-vous, comme le stoïcien Epictète, que puisque « la porte est ouverte », puisque l’on peut choisir de mourir, « si tu restes, ne gémis pas » ?
Je ne suis pas stoïcien, je me sens beaucoup plus proche d’Epicure, mais il y a un point décisif dans la pensée stoïcienne qui me paraît juste : c’est distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend pas
L’esprit du stoïcisme, c’est de désirer ce qui dépend de nous, donc de vouloir et d’agir, plutôt que de désirer ce qui ne dépend pas de nous, donc d’espérer et de craindre. Et comme il ne dépend pas de moi de mourir ou non, je laisse ça au hasard ou à la nécessité. En revanche, il dépend de moi de mourir de telle ou telle façon ; c’est pourquoi je milite pour une légalisation de l’euthanasie volontaire et du suicide assisté. Si je suis maître de ma vie, je dois pouvoir l’être aussi, si je le souhaite, de ma mort.
Qu’avez-vous raté ?
Vous savez ce que dit Sartre : que « l’histoire de toute vie est l’histoire d’un échec »… J’en suis d’accord. On ne réussit jamais tout, et mon but n’est pas de « réussir ma vie », expression qui m’a toujours paru dérisoire. Il s’agit de vivre, et c’est bien assez.
Donc j’ai raté des tas de choses, comme tout le monde, aussi bien dans ma vie privée (mais vous me permettrez de n’en rien dire) que dans ma vie intellectuelle. Par exemple, à 20 ans, je rêvais d’être à la fois philosophe et romancier, comme Sartre. Et il y a bien longtemps que j’ai renoncé à écrire des romans. C’est un échec, mais je m’en console en essayant de réconcilier d’une autre façon – prenant modèle sur Montaigne plutôt que sur Sartre – la littérature et la philosophie.
Quel est le philosophe que vous gardez, à la fin de votre vie, au plus près de
vous ?
Montaigne, parce qu’il est sans doute celui qui est le plus humain. Et c’est pourquoi sa lecture, qui fut tardive, m’a à ce point bouleversé : parce que j’y ai vu une vraie leçon de sagesse. Pas la sagesse absolue d’un Epicure ou d’un Spinoza, qui prétendent être à l’abri du malheur, mais une sagesse de second rang, une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, dont l’esprit se résume dans une phrase dont je me suis fait une espèce de mantra et le titre d’un de mes livres [paru en 2015, chez Albin Michel] : « C’est chose tendre que la vie, et aisée à troubler ». Ce n’est pas une raison pour cesser de l’aimer, au contraire ! Vous savez ce qu’écrit Spinoza : « Ce n’est pas parce qu’une chose est bonne que nous la désirons, c’est inversement parce que nous la désirons que nous la jugeons bonne. »
C’est peut-être cela que j’aurais envie de dire aux jeunes : ce n’est pas parce que la vie est bonne qu’il faut l’aimer ; c’est dans la mesure où nous l’aimons qu’elle devient bonne. Le désir est premier, donc n’attendons pas que la vie soit facile, heureuse pour commencer à l’aimer, commençons à l’aimer y compris dans sa difficulté, dans ses horreurs parfois, pour qu’elle devienne bonne. Montaigne résume tout en une phrase, à l’extrême fin des Essais [parus en 1580] : « Pour moi donc, j’aime la vie. » C’est la vraie sagesse : non pas l’amour du bonheur (pas besoin d’être sage pour aimer le bonheur, n’importe qui en est capable), mais l’amour de la vie, heureuse ou malheureuse, sage ou pas, et bien sûr aucune vie n’est heureuse ou sage dans son entier. C’est une banalité formidable et, en même temps, c’est d’une beauté bouleversante, parce que l’amour de la vie est ce qu’il y a de plus précieux à transmettre à nos enfants
Valentine Faure
Propos recueillis dans Le Monde le 7 Avril 2024.